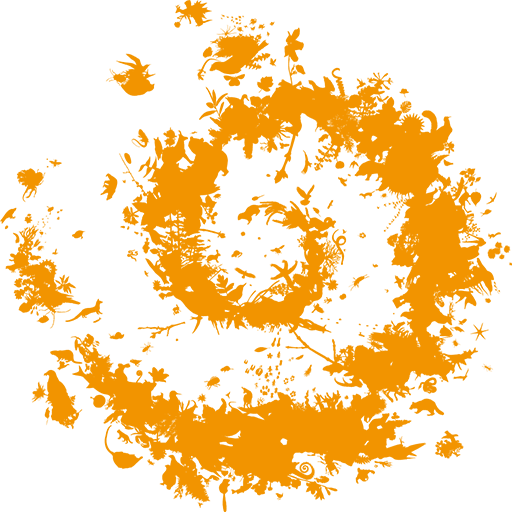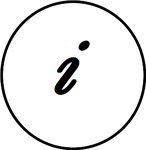Les cascades de l'Hérault - court
Depuis la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée (col de la Serreyrède), ce sentier circule dans la forêt accrochée aux pentes du versant sud du Mont Aigoual. Ponctué d’éclairages variés sur la faune, la flore et la gestion forestière, le parcours progresse vers un spectaculaire belvédère sur les cascades de l’Hérault.
Les 9 patrimoines à découvrir
 Géologie
GéologieLa ligne de partage des eaux
Le relief actuel crée une frontière entre Atlantique et Méditerranée : selon le versant, les eaux coulent vers la mer ou vers l'océan. Ceci est dû au soulèvement du seuil Cévenol, provoqué par l'activité de la faille des Cévennes longeant le Languedoc. Ce seuil marque la frontière géographique par le contraste entre le versant nord-ouest, verdoyant au relief atténué, et le versant sud-et, abrupt où l'érosion est toujours puissante vers des altitudes rapidement très basses en Languedoc. Eau
EauFrontière climatique
Le col constitue aussi une frontière climatique. Quand le versant atlantique, sous vent d'ouest dominant, est arrosé par les pluies assez réparties dans l'année, le versant méditerranéen, plus sec et chaud, oppose au vent de sud-est (le « marin ») qui souffle parfois, une barrière massive obligeant l'air humide à s'élever brusquement. L'eau des nuages se condense alors, ce qui donne parfois lieu aux « épisodes cévenols », où des trombes d'eau s'abattent (600 mm en 24h) provoquant des crues catastrophiques. L'Aigoual, Mt Aigualis, le pluvieux (A. Bernard) porte bien son nom ! Après la Savoie, c'est l'endroit le plus arrosé de France. Milieu naturel
Milieu naturelA la lisière
Cette clairière appartient aux milieux ouverts. Ces milieux lumineux abritent de nombreuses espèces (fleurs, papillons sauterelles…) Certaines d’entre-elles sont même spécifiques aux lisières, « interfaces » entre forêts et clairières. Ainsi la préservation de milieux ouverts, en régression sur le massif, constitue un enjeu important pour la biodiversité.
 Eau
EauStation de suivi des écosystèmes forestiers
Ce petit périmètre grillagé abrite une station de mesure qui permet aux chercheurs de mieux comprendre le rôle joué par la forêt dans la régulation du microclimat et la filtration des polluants. Milieu naturel
Milieu naturelÎlot de sénéscence
Les îlots de sénescence sont des zones de protection au milieu de zones de production. Répartis sur l’ensemble du massif forestier exploité, ils permettent une libre évolution de la forêt. L’apparition progressive de bois mort, d’arbres de grande dimension présentant des cavités ou autres « micro-habitats » favorise l’installation de tout un cortège d’espèces spécifiques. : insectes saproxyliques (mangeurs de bois mort) et champignons mais aussi oiseaux et mammifères. Faune
FauneAuprès du ruisseau
Après la descente dans la hêtraie sapinière, vous voilà tout près de l’Hérault. Peut-être y apercevrez-vous un petit oiseau vif et élancé, gris dessus, jaune vif dessous, hochant la queue et virevoltant à droite ou à gauche à la poursuite d’un insecte ou fouillant les bords du cours d’eau à la recherche de larves ? Pas de doute, c’est la bergeronnette des ruisseaux ! Flore
FloreUne hêtraie de production
L’altitude et les importantes précipitations offrent aux hêtres un milieu favorable. De plus, cette essence sait recueillir, à la manière d’un entonnoir, une partie de l’eau captée par les feuilles : celle-ci ruisselle le long du tronc sur l’écorce très lisse pour atteindre les racines. De part et d’autre du chemin, les arbres ont des morphologies bien différentes : à droite ils se présentent sous forme de taillis pour le bois de chauffage, et à gauche sous forme de futaie «sur souche» potentiellement utilisables en bois d’œuvre. Flore
FloreUne forêt en libre évolution
Le chêne blanc, pubescent ou « rouvre », s’implante naturellement entre 500 et 1 000 m. Ici exposé au sud, à l’abri des vents dominants et sur un sol maigre de zone rocheuse, il sort vainqueur de la compétition et se hisse au-delà de sa limite habituelle d’altitude. Contrairement au hêtre, le chêne est une essence de lumière : notez la différence de recouvrement des houppiers et la richesse de la végétation au sol. Cette zone est « évolution naturelle », aucune exploitation n’y est réalisée. De nombreuses espèces sont observables : sorbier des oiseleurs, érable plane, alisier blanc... Eau
EauDeux cascades... cherchez l'Hérault !
Hésitant entre débit et longueur devant ces deux brins de rivière, les géographes ont finalement désigné le cours en contre bas comme l’Hérault, alors que la cascade en face a été baptisée la Dauphine. Deux plantes remarquables sont présentes ici : le grand orpin, avec ses feuilles « grasses » consommées par les chenilles d’un papillon en fort déclin sur tout le Massif central : l’apollon (à observer entre la mi-juillet et la mi-août) ; la saxifrage de Prost qui forme des coussinets réguliers facilement reconnaissables. Ils permettent de mieux conserver le peu d’eau disponible. C’est une plante endémique des Cévennes.
Description
- Départ : Maison de l'Aigoual
- Arrivée : Maison de l'Aigoual
- Communes traversées : Val-d'Aigoual
Météo
Profil altimétrique
Recommandations
Sentier étroit et escarpé, bonnes chaussures indispensables. Les randonnées équestre et à VTT ne sont pas autorisées ou adaptées sur les sentiers d'interprétation.
Lieux de renseignement
Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes, La Serreyrède
Col de la Serreyrède, 30570 Val d'Aigoual
La Maison de l'Aigoual abrite l'office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes et la maison du Parc national. C'est un espace d’accueil, d'information et de sensibilisation sur le Parc national des Cévennes et ses actions, sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc.
Sur place : expositions temporaires, animations au départ du site et boutique
Transport
Accès routiers et parkings
Col de la Serreyrède, par la D 986 Camprieu - Valleraugue ou par la D 48 depuis Le Vigan
Stationnement :
Source
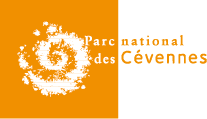
Signaler un problème ou une erreur
Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :