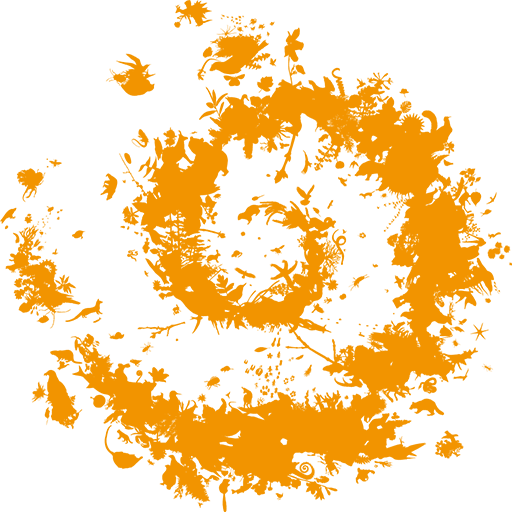Cévennes panoramiques par le mont Lozère -Trail
Empruntez la grande draille du Languedoc au Gévaudan, qui conduisait les troupeaux de moutons à l'estive. De crêtes en cols, découvrez le paysage granitique du mont Lozère, les landes et châtaigneraies de la montagne du Bougès pour finir par les steppes de la Can de Ferrières !
Les 24 patrimoines à découvrir

La croix des missions - Nathalie Thomas  Histoire
HistoireLa croix des Missions
Sur la commune du Bleymard, on trouve un grand nombre de calvaires et autres ouvrages du petit patrimoine religieux, témoins de la ferveur qui animait les habitants. On les trouve à l’entrée du village, sur la place, ainsi qu’au carrefour des chemins, protégeant le marcheur et le laboureur. Des offrandes prenaient parfois la forme de croix, alors appelées « des missions ».

Pie-grièche écorcheur - Régis Descamps  Faune
FauneLes passereaux
Les milieux ouverts, composés de quelques arbres et de buissons, sont favorables aux passereaux. Cet ordre est le plus vaste et le plus varié de la classe des oiseaux et regroupe plus de la moitié des espèces d’oiseaux. La pie-grièche écorcheur affectionne particulièrement ce type de milieux, riches en gros insectes qui constituent sa principale source de nourriture. Cet oiseau est une espèce migratrice stricte et hiverne dans l’est africain.

Paysage - © Brigitte Mathieu  Flore
FlorePelouse subalpine
Comme dans un jardin ou sur un terrain de sport, les pelouses sont travaillées par l’homme. Le pâturage et le feu sont ici les outils de leur entretien. L’essentiel des plantes qui la constituent sont des cousines du blé et des graminées vivaces : le nard, les fétuques. Coupez (broutez) une de leurs tiges, il s’en forme bientôt cinq autres ; piétinez- les, elles se multiplient, elles deviennent très denses. Toutes ces «tortures» offrent les conditions d’un couvert végétal serré, garant de la stabilité d’un sol pauvre, pourtant noir, issu de l’altération du granite omniprésent. Voilà donc quelques clés pour une gestion adaptée de ce milieu fragilisé en cas d’abandon.

Frutgères - nathalie.thomas  Architecture
ArchitectureFrutgères
Ce village, autrefois chef-lieu de la paroisse, s'était développé bien avant le Pont-de-Montvert, qui n'était qu'un hameau, devenu un petit bourg d'une soixantaine de personnes en 1631. Au XIIe siècle, dans la paroisse de Frutgères, à l’Hôpital, s'est installée l'importante Commanderie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, ordre religieux et militaire qui prendra le nom d' « ordre des chevaliers de Malte ». L'église paroissiale, qui en dépendait, a été brûlée par les Camisards, responsables en 1702 de l'assassinat du curé de Frutgères, l'abbé Reversat, au lendemain du meurtre de l'abbé du Chaila au Pont-de-Montvert a été créée par la réunion des paroisses de Frutgères et de Grizac. Au début du XIXe siècle, la commune a connu une importante densité de population (25 habitants / km²). Dans les grandes propriétés de Frutgères il fallait beaucoup de main d’œuvre pour les récoltes de foin, de seigles et de sarrasin.

 Histoire
HistoirePont-de-Montvert
Le Pont-de-Montvert est entièrement protestant à la fin du XVIe siècle. En 1702, pour une population globale de cinq cents habitants, le bourg compte seulement une trentaine d’anciens catholiques. En 1686, l’abbé du Chaila est nommé archiprêtre des Cévennes, inspecteur des missions et des chemins de traverses. Il s’approprie la maison de Jean André, notable protestant qui a refusé d’abjurer sa religion et pris le Désert. L’abbé du Chaila reconvertit la maison André en résidence administrative mais surtout en lieu de détention et d’interrogatoire.

Le Pont-de-Montvert - © Guy Grégoire  Histoire
HistoirePont-de-Montvert
Balise n° 12
Le Pont-de-Montvert est à la confluence du Tarn et de deux de ses affluents, le Rieumalet et le Martinet. La draille, ancien chemin de transhumance aujourd’hui presque effacé, était empruntée par les troupeaux du Midi pour rejoindre les estives du mont Lozère. C’est le long de cet axe que les premiers quartiers se sont développés. En 1630, le bourg était déjà presque aussi étendu qu’au début du XIXe siècle. Trois ponts de pierre ont été construits. Mais les grandes crues de 1827 et 1900 ont sérieusement endommagé ou détruit ces ouvrages : le grand pont sur le Tarn est le seul encore en pierre. Les nouveaux quartiers se sont installés à la périphérie du bourg, préservant le centre historique.
Chemin des camisards - © Brigitte Mathieu  Histoire
HistoireChemin des Camisards
Balise n° 11
Ce chemin, autrefois itinéraire de grande communication, reliait le Pont-de-Montvert à Barre-des-Cévennes. Dans la nuit du 24 juillet 1702, des Huguenots qui s'étaient précédemment rassemblés au col des Trois Fayards ont emprunté ce chemin pour libérer leurs coreligionnaires détenus par l’abbé du Cheyla au Pont-de-Montvert. Les événements tragiques qui ont suivi (mort violente de l’abbé du Cheyla) ont déclenché la guerre des Camisards. Les paysages alentours résultent d’une intense activité agricole : toutes les pentes avoisinantes étaient cultivées (seigle essentiellement) sur des terrasses construites de main d’homme, les bancels.
 Géologie
GéologieBoule qui roule
Balise n° 10
Sur le plateau, le chemin est parfois peu marqué, signe d’une faible érosion. Par contre, toute la descente sur le Pont-de-Montvert porte les traces d’une érosion plus forte, notamment près du départ où un gros bloc a roulé au milieu du chemin. C’est le passage répétitif des hommes et des animaux qui, ajouté aux facteurs naturels, a fini par déstabiliser ce rocher. À la suite de ces événements, le chemin initial a été dévié.
 Architecture
ArchitectureBergerie couverte en lauzes de schiste
Balise n° 9
Cette bergerie, contrairement à la précédente, est construite en matériaux lourds, compacts et massifs. Une voûte en pierres de granite remplace la charpente en bois. Cela témoigne de la rareté du bois. L’étanchéité de la couverture est assurée par des lauzes de schiste posées sur un lit d’argile ou d’arène granitique.
Ce lieu se nomme la jasse de Chanteloup (jasse-jas-gisant : lieu de repos pour les animaux ; canteloube, selon l’étymologie populaire : lieu où hurlent les loups ou, selon des sources savantes, luppe :pierre, hauteur, montagne arrondie).
 Paysage
PaysagePanorama
Balise n° 8
Vue sur le flan sud du mont Lozère.
 Architecture
ArchitectureBergerie en ruine
Balise n° 7
Il faut quitter le chemin sur la gauche, et parcourir environ 200 mètres pour découvrir l'ancien abri pour les animaux domestiques (ovins, bovins). Les matériaux de construction étaient pris sur place : granite pour les murs, pin sylvestres ou chêne pour la charpente, paille de seigle pour la couverture. Localement, on cultivait une variété de seigle à paille fine et longue. Coupé à la faucille fin-juillet et mis en javelles, le seigle était stocké en meules et dépiqué (battu) au fléau sur les aires à battre. Ensuite, il fallait confectionner de petites gerbes qui étaient mouillées avant utilisation pour faire germer les dernières graines et rendre la paille moins cassante à la pose.
Prairie vers l'Hermet - © Guy Grégoire  Milieu naturel
Milieu naturelAlternance de landes à callune et de prairies de fauche
Balise n° 6
La callune est installée sur les croupes, c’est à dire les parties convexes (sols pauvres et secs), tandis que les prairies occupent les parties concaves, sur des sols plus profonds et humides. Toutes ces terres offrent des ressources alimentaires à une faune spécifique. On y rencontre des lièvres, des rapaces (buse, busards Saint-Martin et cendré, circaète Jean-le-Blanc, faucon crécerelle) et des perdrix rouges.
 Faune
FauneFaune de la pineraie
En association avec la myrtillaie, les pins sylvestres forment un milieu favorable à la faune. Cerfs et chevreuils y broutent les plants de myrtilles. Les sangliers, les renards, les martres et tous les oiseaux consomment leurs baies, notamment le grand tétras, grand oiseau forestier, qui a été réintroduit ici par le Parc national. On y trouve également la mésange noire, la mésange huppée, le troglodyte, le rouge-gorge, la grive draine et le pic noir. Certains rapaces, tel le circaète Jean-le-Blanc, peuvent venir confectionner leur nid en haut d’un pin sylvestre étêté.

 Histoire
HistoireChamplong-du-Bougès
Cette ancienne auberge, aujourd’hui maison forestière, et ses environs ont été le cadre de nombreuses assemblées. En juillet 1702, elle était habitée par la famille Jalabert, dont Jeanne l’une des filles était prophétesse.

Sorbier des oiseleurs - © com com Florac Sud Lozère  Milieu naturel
Milieu naturelSorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Sorbus serait un dérivé de sorbitio (breuvage, tisane) et aucuparia viendrait de auceps, oiseleur. A l'automne, les oiseleurs se servaient de sorbes comme appâts dans les tendelles, des piège à grives. On raconte que certains enduisaient les branches de cet arbre de glu pour capturer les oiseaux. Plus simplement, les chasseurs guettaient auprès de l'arbre pour chasser merles et grives. (P. Grime)

Temple de Cassagnas fraîchement rénové - © com com Florac Sud Lozère  Histoire
HistoireCimetières protestants
« Étrange Cévenne toute pavée de tombes ! On les trouve à l'ombre du mas … elles ne sont le plus souvent indiquées que par une lauze plantée en terre, elles n'ont ni croix, ni ornements… Lorsque la famille est cossue, elles s'enrichissent de ce casier en zinc qui abrite des couronnes… Il y a ainsi d'innombrables propriétés où la population couchée est dix fois plus forte que la population debout !» (Roussel Romain, Almanach Cévenol 1968).

Circaète Jean-le-Blanc - © Régis Descamps  Faune
FauneCircaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Le circaète Jean-le-Blanc niche dans les boisements environnants. Les meilleures périodes pour l'observer sont mars-avril et juillet-septembre. Cet oiseau passe l'hiver bien au chaud en Afrique noire et revient en France au début du mois de mars. Pendant plus de cinq mois, avec son partenaire, il couve son unique œuf et élève son poussin.

 Histoire
HistoirePlace de la Madeleine
Balise n° 5
La fontaine date du XVIIIe siècle. La tête de Marianne, personnification de la République, a été ajoutée à la fin du XIXe s. A la même époque, un peuplier, symbole de la liberté, a été planté par la jeunesse républicaine. De cet endroit, on peut voir quelques maisons bourgeoises, qui datent pour la plupart du XVIIe et du XVIIIe siècles. Elles témoignent du passé florissant de ce village, qui comptait une vingtaine de voituriers (marchands-transporteurs) qui descendaient vers la plaine, chargés de laine et de châtaignes, et remontaient avec du sel, du vin et de l’huile. De larges porches permettaient d’abriter les attelages et les charrettes. Les jours de foires, le marché aux grains s’installait sous ces voûtes et sous celles de la mairie.
 Histoire
HistoireChâteau
Balise n° 6
Édifié au XIIe et au XIIIe siècle, il a été entièrement reconstruit vers le début du XVIe siècle. De 1710 à 1715, il a été remanié par le seigneur de Barre qui a fait graver ses armoiries au-dessus de la porte d’entrée. A cette époque, deux tours ont été ajoutées. Pendant la Révolution, les armoiries ont disparu, victimes d’un vigoureux martelage. Au début du XIXe siècle, la tour maîtresse a été supprimée lors d’un agrandissement.
 Histoire
HistoirePlace de la loue
Balise n° 1
Sur cette petite place, située à l’entrée nord-ouest du village, se tenait lors des grandes foires de printemps et d’automne, la “loue”: des bergers, des domestiques ou des ramasseurs de châtaignes attendaient, assis sur le parapet, qu’un éventuel employeur les embauche. Le village accueillait douze à quinze foires par an. Celles du printemps et de l’automne pouvaient attirer jusqu’à dix mille personnes venues des départements limitrophes, mais aussi du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Ce village-rue était protégé à chacune de ses extrémités par une porte fortifiée. L’une d’entre elles se dressait près de la place de la Loue : appelée porte de Florac, détruite au début du XIXe siècle.
 Histoire
HistoireBarre-des-Cévennes
Dès 1530-1540, la Réforme touche ce village-rue, célèbre pour ses treize foires annuelles. Une pierre gravée comportant l’inscription « Qui est de Dieu oit la parole de Dieu – 1608 – », provenant du second temple de Barre, est toujours visible sur le mur d’une des maisons de la Grand rue. Lors de la guerre des camisards, Barre devient la « capitale » administrative des Hautes-Cévennes. Les autorités renforcent alors ses défenses et augmentent les effectifs de la garnison installée depuis 1684. Barre est le lieu de naissance du célèbre camisard et prophète Elie Marion (1678-1713).

La Can de Ferrières - © Guy Grégoire AgricultureLa can de Ferrières
Ce plateau calcaire est encore aujourd'hui pâturé par des troupeaux de moutons. Observez les tas de pierre qu'on nomme "clapas". Ils ne sont pas là par hasard ! Ils résultent de l'empierrement par l'homme des champs mais aussi des parcours. Ces amas de pierres servent d'abris pour de nombreuses espèces.

bord de rivière trace castors - pnc  Eau
EauLe Tarnon et ses rives
La préservation de la végétation des rives, riche en habitats rares est un enjeu majeur qui justifie un classement d’intérêt européen « Natura 2000 ». Présents sur le Tarnon, la Loutre et le Castor d’Europe, de mœurs crépusculaires et nocturnes restent difficiles à observer. Le poisson est l’aliment de base de la Loutre, le Castor se nourrit des saules croissant sur les berges. La ripisylve, formation boisée ou arbustive occupant les rives, contribue à la biodiversité et limite l’érosion des berges, car lors des épisodes cévenols, les crues peuvent atteindre 6 mètres de hauteur.
PROHIN Olivier_pnc  Histoire
HistoireL’ancienne gare et le pont en fer
Cette gare était le point de départ de la ligne Florac - Ste Cécile d’Andorge. Exploitée de 1909 à 1968 par les Chemins de Fer Départementaux (CFD), cette voie reliait la sous-préfecture Lozérienne à la ligne St. Germain des Fossés/Nîmes qui désenclavait les Cévennes. Aujourd'hui elle renaît comme Voie verte "La Cévenole". Le pont traversant le Tarnon, construit en 1890 sur le modèle Eiffel, fut un des premiers ouvrages métalliques réalisés à cette époque.
Description
Jour 1 : La Bastide-Pyulaurent--Le Bleymard (entre 5h et 6h30), 850m D+, 800m D-. GR®7.
Monter sur les crêtes et le Moure de la Gardille, où l'Allier prend sa source . Puis descendre sur Belvezet, et rejoindre le carrefour de la pierre plantée. Monter vers le Plot de l'Aygue pour redescendre sur Le Bleymard par quelques courtes portions abruptes.
Jour 2 : Le Bleymard--Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère (entre 4h et 5h30), 650m D+, 850m D-. GR®7 puis GR®72.
Du Bleymard monter jusqu'à la station du Bleymard-mont-Lozère, puis au col de Finiels. Au col descendre sur Salarial, L'Hôpital et le Pont du Tarn. Au Pont du Tarn bifurquer sur le GR®72 pour rejoindre Le Merlet puis Le Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère.
Jour 3 : Pont-de-Montvert-Sud-mont-Lozère-Barre-des-Cévennes, (4h30 à 6h), 900m D+, 850m D-, GR®72
Rejoindre le Col de la Planette par Champlong de Bougès. Au col rejoindre Barre-des-Cévennes par Cassagnas, Relais de Stevenson, Le Crémadet, Les Quatre chemins, Barre-des-Cévennes.
Jour 4 : Barre-des-Cévennes--Florac-Trois-Rivières (2h à 3h), 220m D+, 600m D-, GR®7puis GR®43
De Barre-des-Cévennes prendre le GR®7 pour rejoindre le col des Faïsses par la Can Noire. Au col des Faïsses quitter le GR®7 pour prendre le GR®43 direction Florac par le col du Rey, Tardonenche, La Rouvière, Pont de Barre.
Lien flyer:
- Départ : La Bastide-Puylaurent
- Arrivée : Florac-Trois-Rivières
- Communes traversées : La Bastide-Puylaurent, Mont Lozère et Goulet, Luc, Cheylard-l'Évêque, Saint-Frézal-d'Albuges, Cubières, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère, Cassagnas, Barre-des-Cévennes, Cans et Cévennes, Vebron et Florac Trois Rivières
Météo
Profil altimétrique
Recommandations
Avant de vous engager sur un circuit, vérifiez qu'il est adapté à votre activité et à votre niveau. N'oubliez pas que le temps change vite en montagne. Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante.
Lieux de renseignement
Maison du tourisme et du Parc national, Florac
Place de l'ancienne gare, N106, 48400 Florac-trois-rivières
Une expo interactive présente le Parc national des Cévennes et ses actions.
Sur place : Une boutique, librairie découverte et produits siglés PNC.
Ouvert toute l'année (se renseigner sur les jours et horaires en saison hivernale).
Transport
Depuis Florac: retour par bus sur Mende (ligne 251) ou Alès (ligne 252) :
Depuis Mende ou Alès: retour à La Bastide-Puylaurent par TER / www.ter.sncf.com/occitanie
Transport de personnes et de bagages : www.lamallepostale.com/fr
Accès routiers et parkings
Depuis Mende, N88 direction Laubert, puis D6 par Les Chazeaux et La Bastide-Puylaurent.
Depuis Alès par la D906 en passant par Villefort.
Stationnement :
Calculateur d'itinéraires liO
Utilisez le calculateur liO pour organiser votre trajet en région Occitanie.
Autres régions
Calculez votre itinéraire en Auvergne Rhône Alpes sur Oùra
Biodiversité autour de l'itinéraire
Source



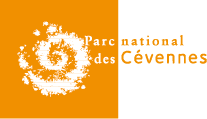
Signaler un problème ou une erreur
Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :